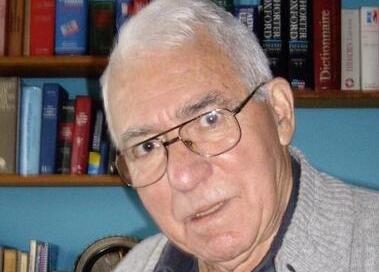Daniel Coste

Peux-tu nous rappeler ton parcours comme l’ont fait avant toi d’autres collègues de la SIHFLES ?
Tu me fais beaucoup d’honneur, mais tu commets aussi sans doute une erreur de casting, en me proposant, avec une amicale insistance, de m’inscrire dans la galerie des auto-portraits assistés de « la SIHFLES au singulier ». Sauf à prendre au pied de la lettre la singularité. Car, à la différence notable des collègues qui ont nourri cette rubrique, je ne saurais prétendre à une compétence d’historien de notre domaine. Ma fréquentation des dossiers d’archives a été plus que réduite, je ne me suis guère penché sur les ouvrages anciens des bibliothèques, mes curiosités directes pour le passé ont remonté tout au plus jusqu’au xixe siècle et mes publications dans ce secteur sont bien légères. Pas de quoi alimenter des réponses aux questions pertinentes habituellement posées à tes interviewés mieux qualifiés. Membre fondateur et premier président de notre société, j’ai bien conscience d’avoir d’abord eu un rôle organisationnel dans l’entreprise patiente qu’avait suscitée André Reboullet et où, parmi les personnalités scientifiques autres que françaises qu’il avait su faire venir à Sèvres pour une sorte d’assemblée constituante, on trouvait Carla Pellandra, Elisabet Hammar, Herbert Christ, Konrad Schröder… De là à avoir voix à ton chapitre, tu as entendu et tu sais mes réticences !
Mais tout de même…
Disons que mon intérêt pour l’histoire de l’enseignement et de la diffusion du français est ancien, mais de circonstance, et touchant d’abord à la période contemporaine. Circonstance, un mémoire pour le diplôme d’études supérieures, au retour d’un séjour aux États-Unis, qui me fait travailler sur les rapports entre la linguistique structurale distributionnelle et la naissance de la linguistique appliquée. Circonstance, le centenaire de l’École normale supérieure de Saint-Cloud et l’organisation de journées d’étude sur la politique linguistique de diffusion du français après 1945. Circonstance, lors de mon passage à l’Université de Genève, le vingtième anniversaire de l’École de langue et de civilisation françaises, puis le centenaire du Séminaire de français moderne : occasions nouvelles de rencontres et de colloque. Circonstance enfin, le cinquantenaire de la publication du Français fondamental et l’initiative d’un nouveau colloque en cette année 2005. Tu admettras volontiers avec moi que cette compulsion commémorative de l’histoire n’est ni la mieux fondée ni la plus prisée ! Surtout lorsqu’elle s’attache à des événements relativement récents, qui n’ont pas un statut de lieux de mémoire…
Il n’y a peut-être pas là que circonstances occasionnelles ?
Peut-être en effet, dans la mesure où ces « occasions » successives finissent par produire une certaine conception – certes pas une théorisation et encore moins un modèle – de ce qui contribue à des changements dans les déroulements historiques qui nous intéressent. Ainsi, pour reprendre deux cas marquants, l’époque de la méthode directe et celle du Français fondamental : toutes deux sont marquées par des conjonctions ou du moins des coïncidences entre divers ordres de phénomènes : enjeux de la colonisation ou de la décolonisation, évolution des systèmes éducatifs et universitaires, nouveaux modes de penser le langage et l’apprentissage, apports technologiques et intérêts commerciaux, choix de politique linguistique et mise en place d’institutions originales. Dans ce complexe de déplacements, les débats d’ordre méthodologique et pédagogique, les manières d’enseigner ont à coup sûr leur rôle et leur importance, tout comme les objets retenus par les grammairiens ou les linguistes et les descriptions qu’ils en proposent. Mais il me semble que, chaque fois que possible, nous avons tout intérêt à remettre en contexte notre exploration de ce qui bouge dans l’enseignement des langues et dans les représentations circulantes à leur propos, à resituer cet ordre d’observables à l’intérieur d’ensembles plus vastes.
Mais en avons-nous les moyens et, en outre, ne faut-il s’intéresser qu’à des moments de changement apparent ? Bien des travaux menés au sein de la SIHFLES ont plutôt mis en évidence des continuités, voire des constantes, dans les questionnements aussi bien que dans la pratique, et cela au travers et comme au mépris de bouleversements historiques multiples. Les périodisations ne semblent pas être de même empan pour les différents niveaux que tu évoques, les temporalités ne coïncident pas.
Avons-nous les moyens de cette mise en contexte ? Certes pas à nous seuls, mais les historiens de métier existent, et nombre de leurs travaux – relevant d’ailleurs de tendances et de méthodes distinctes – sont accessibles, que nous n’avons peut-être pas aussi sollicités, aussi mobilisés jusqu’à présent que nous aurions pu le faire.
Cela dit, je suis bien conscient de forcer l’argument : il suffit de reparcourir les numéros de Documents pour y relever de multiples prises en considération de l’histoire avec un grand H, qu’il s’agisse de la Révocation de l’Édit de Nantes ou de la période du fascisme. Sans oublier tel colloque tenu à Utrecht où le problème de ces relations a été clairement posé ! En outre, il est clair que la priorité était bien d’abord de circonscrire un domaine et des objets spécifiques de recherche avant de mettre ce domaine et ces objets au contact d’autres.
Mais, d’une certaine manière, ta deuxième interrogation tient du « est-ce bien nécessaire » et rendrait presque vaine la première : à quoi bon en effet chercher à resituer nos observations dans des évolutions plus larges ou en rapport à des phénomènes autres, si les périodisations ne sont aucunement superposables, si l’enseignement du français aux étrangers vit et se transforme, pour l’essentiel, à son propre rythme ? Ce constat d’une relative singularité, d’un décrochage autonome, devait être premier et il a d’autant plus permis d’affirmer l’existence propre de notre domaine que les représentations ordinaires qu’on pouvait en avoir le présentaient parfois comme un espace de changements (et de progrès) continus, alignés sur les avancées scientifiques et technologiques. Mais il me semble toutefois aussi que nous entrons désormais plus résolument dans une nouvelle phase, une phase où des mises en relation deviennent nécessaires.
C’est-à-dire ?
Une phase que désignait Herbert Christ dans ton précédent entretien. Celle où il y aurait lieu de contraster des données relatives à différents pays, peut-être aussi à des langues différentes. Par exemple, le mouvement de la Réforme, né en Allemagne à la fin du xixe siècle, a connu des avatars et des succès variables en Europe du Sud au regard de ce qui se passait plus au Nord ; et l’Italie et la France ne le reçoivent pas de la même manière ni au même moment. C’est cela aussi dont il faut essayer de rendre compte, en termes peut-être de contexte national, d’enjeux disciplinaires, d’affirmations identitaires, de traditions culturelles, d’image attachée à telle ou telle langue enseignée ou diffusée dans tel lieu… D’une façon générale, on pourrait dire que si l’histoire de l’enseignement des langues comporte à l’évidence des « fondamentaux », quant aux grandes conceptions de l’apprentissage ou aux options majeures selon lesquelles se déclinent les pratiques (la thèse d’Henri Besse traite, me semble-t-il, de tels « fondamentaux »), il y a étudier comment ces fondamentaux s’actualisent selon les époques, les voies et les espaces de diffusion, les langues, les institutions, les politiques locales ou nationales. Pour un peu, en un tout autre sens qu’au début de notre échange, on irait vers une histoire intégrant pleinement les « circonstances ».
A cet égard, il me paraît important et significatif que l’équipe de nos collègues italiennes, sans abandonner le recueil systématique des manuels et grammaires et tout en continuant à procéder méthodiquement à un travail d’archives et de bibliothèque, s’engage aujourd’hui, autour de Nadia Minerva, dans un recensement et une analyse de revues pédagogiques du xixe et du xxe siècles. Significatif aussi que le dernier colloque de la SIHFLES, à Valence, ait concentré l’attention sur le cheminement d’une professionnalisation des enseignants de langues, en faisant apparaître des différences notables de pays à pays. Dans tous ces cas, des similarités substantielles existent, mais c’est la variation apparemment accidentelle qui devient objet de questionnement. Et dans tous ces cas aussi, il faut bien s’interroger sur les facteurs historiques autres à prendre en compte, à partir des données spécifiques et nouvelles qu’on a d’abord recueillies, construites, analysées.
En revient-on alors à la recherche de causalités externes, voire à des déterminismes de type infrastructure / superstructure, comme on a pu les affirmer il y a quelques décennies ? Quand même ils seraient, « en la circonstance » de portée locale ?
Surtout pas ! Des travaux aussi divers que ceux de Willem Frijhoff aux Pays-Bas, de Herbert Christ ou de Konrad Schröder en Allemagne, d’André Chervel ou de Jean-Claude Chevalier et Pierre Encrevé en France, sans revenir sur tout ce qui s’est fait en Italie, en Espagne et dans d’autres pays, ont bien mis en évidence les interactions, les jeux d’action et de rétroaction, entre différents ordres de phénomènes, souligné aussi combien les pratiques culturelles, les institutions éducatives, les activités et publications scientifiques ni ne sont isolables d’un environnement et d’une époque, ni ne sont explicables de part en part par cet environnement et cette époque qu’elles contribuent aussi à façonner et à transformer… Pardonne-moi ces lieux communs, mais tu sais bien qu’il est précieux pour nous qu’ils le soient, communs.
Et les commémorations dans tout cela ?
Celles qui m’ont intéressé ont trait à des circonstances particulières. Elles marquent, à distance de quelques décennies ou quelques siècles, qu’on reconnaît une portée et une importance à un événement qui devient rétrospectivement significatif d’autre chose aussi que de lui-même. Un tournant, un moment où des temporalités de rythmes divers, pour une fois, se rencontrent et semblent coïncider, un moment aussi où des acteurs aux personnalités souvent fortement individualisés s’inscrivent dans un mouvement qui va bien au-delà d’eux-mêmes, où l’histoire au plus long cours et l’histoire « événementielle » s’accordent en un point, qui peut d’ailleurs être aussi un point de rupture. Le 14 juillet est évidemment plus que la prise de la Bastille, tout comme, à une autre échelle bien entendu, la publication du Français fondamental ne se réduit pas à un petit fascicule contenant une liste de mots ni celle de la Grammaire de Port Royal à un nouvel essai de description linguistique. Il faut se méfier, certes, des commémorations, mais aussi y prêter attention pour ce qu’elles nous disent, non seulement de l’occasion, mais aussi d’un autour, d’un avant et d’un après. Ce sont, sinon toujours des lieux de mémoire, du moins des points d’observation où travailler aussi bien à la loupe qu’à la longue vue ou au périscope, pas seulement au rétroviseur. C’est en cela, je crois, qu’elles peuvent constituer pour nous des occasions où multiplier les regards et les perspectives.
Mais tu m’as entraîné à trop métaphoriser… Et mieux vaut s’en tenir là de ces propos qui sont en effet plus de circonstance que de consistance !
(Propos recueillis par Michel Berré.)