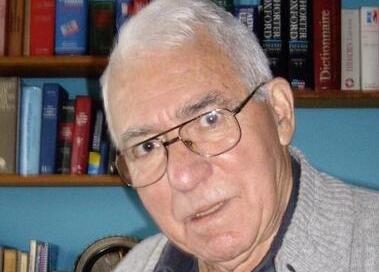Willem Frijhoff (1942, Zutphen – 2024, Rotterdam, Pays-Bas)

Chemins de traverse en francophonie
J’ai toujours été un passionné d’histoire. L’approche diachronique ou génétique, par le devenir d’une personne, d’une institution, d’un mouvement d’idées ou d’un pays, est devenue ma seconde nature. En bon élève je me soumettrai donc ici à ma propre méthode. Ce sera cependant un chemin de traverse. Si je suis un Sihflésien, ce n’est pas pour l’étude de la langue elle-même mais par le biais de la langue comme instrument et objet de culture.
Comment suis-je venu à la francophonie? Rien ne m’y prédestinait. J’avais bien du côté de mon père une bisaïeule francophone hennuyère, dont les prénoms Nathalie Eugénie Joséphine laissent entrevoir l’attachement de ses parents à l’Empire, ou leur compassion pour les épouses Bonaparte. Mais en dépit de ces beaux prénoms français qui depuis lors ont sillonné sa descendance, ma famille tant paternelle que maternelle est depuis toujours rigoureusement germanique, rhénane et batave. Bien sûr, au lycée j’ai pu profiter du professeur de français le plus merveilleux qui soit – le genre qui ne vous apprend pas seulement la langue mais vous fait aimer le pays, son histoire, ses lettres et sa culture. Il m’enthousiasma au point qu’un jour je lui rendis un devoir sur Prosper Mérimée… en vers français. Un micmac horrible, sans aucun doute, mais c’était la preuve de ma sympathie pour la langue qu’il enseignait. Les Hollandais, dès qu’ils s’enthousiasment, s’expriment en vers – voyez leurs exploits pour les cadeaux et ‘surprises’ de la Saint-Nicolas… C’est certainement grâce au travail discret mais efficace de mon prof que je reçus au baccalauréat en 1960 le prix de français. C’était un livre illustré, signé par l’ambassadeur lui-même: Carcassonne, sa cité, sa couronne. J’ai toujours choyé ce premier livre de français de ma propre bibliothèque, et – croyez-le ou non – si je n’ai encore jamais mis les pieds dans la cité de Carcassonne, je connais, pour ainsi dire, cette ville comme ma poche.
Après mon bac, je suis allé étudier la philosophie et la théologie dans les grands séminaires de l’archidiocèse d’Utrecht. Mon professeur de philosophie, qui plus tard devait être nommé évêque de Groningue, était un féru de l’existentialisme. Nous lisions l’Être et le néant dans le texte, et quand en 1961 Maurice Merleau-Ponty mourut, nous fîmes une veillée en sa mémoire. Les pères Chenu et de Lubac berçaient mes études de théologie. Peu de séminaires français ont montré à cette époque une telle ouverture à l’extérieur. Ce fut une formidable école d’éveil, dont je suis resté reconnaissant même après ma séparation du service de l’Église. Cette même Église m’avait pourtant donné une nouvelle preuve d’ouverture en me permettant de choisir moi-même l’université étrangère où je pouvais poursuivre mes études aux frais d’un mécène du monde des affaires (C&A, pour ne pas le nommer). Je choisis Paris, et la 6e section de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes (l’actuelle EHESS Ecole Pratique des Hautes Etudes en Sciences Sociales ), pour y faire de l’histoire, en raison de la réputation dont jouissait alors l’École des Annales à l’étranger. Ce fut une déception amère – du moins jusqu’au moment de la grande ouverture de mai 68 et de mon propre éveil à une façon autre de faire de l’histoire et d’aimer la culture. J’échouai donc en septembre 1966 dans un foyer pour étudiants qui sortit tout droit du Moyen Age et allai m’inscrire à la Sorbonne, université massifiée à l’excès et décevante parmi toutes dans une France totalement surannée, misogyne et xénophobe, sous le règne d’un général triste et misanthrope qui aux yeux du Batave naïf que j’étais ne pouvait qu’incarner l’arrogance bête et fermée au monde extérieur qui depuis lors a fait, hélas! le malheur de la langue française. A force de fermer les yeux devant ce qui se passait dans le monde et de croire que la rhétorique pontifiante qu’était la culture à la Malraux allait conquérir la planète, la francophonie s’est tuée elle-même partout où elle n’a pas pu s’imposer par la force politique ou militaire. En Hollande, par exemple. C’est triste mais vrai. Les demi-francophones ordinaires dont je suis, qui ne vivent pas dans le sérail des études littéraires ou linguistiques, passent leur temps à proclamer à tout vent qu’il y a autre chose dans le monde que l’anglophonie et la globalisation à l’américaine. Mais en dehors des sections de français à l’université ou de l’Alliance française il reste bien peu de niches de bonne volonté à l’égard de la francophonie. Et il ne suffit pas d’être anti-Macdo pour créer une autre culture.
J’ai retrouvé la langue française par un autre biais, comme objet d’étude. Travaillant comme chercheur à l’EHESS, entre 1970 et 1981, je me suis fait spécialiste de la culture de l’époque moderne, en particulier de l’éducation et des phénomènes, formes et mouvements de transfert culturel. Un des principaux instruments de ce transfert est précisément la langue. Le Hollandais des années 1940 que je suis a un énorme avantage sur les Français, comme d’ailleurs sur les Hollandais du XXIe siècle: il a été formé dans cet univers multilingues qu’était son pays avant l’américanisation galopante des années 1970-80. Celle-ci a frustré les Pays-Bas de leur singularité plurilinguistique et de leur position clé dans le Babel européen. À l’école de ma jeunesse, les langues dominaient tout l’enseignement, et à part le français, l’allemand, l’anglais et le néerlandais obligatoires (sans même parler du latin et du grec), nous apprenions en dehors des cours pour notre plaisir, auprès de professeurs bienveillants, l’italien, l’espagnol, un peu de russe, et un soupçon d’espéranto et d’hébreu. On croyait en l’entente mondiale par le respect des langues. J’y ai ajouté plus tard le frison et le catalan. Avec ce cocktail le portugais devient compréhensible, et la proximité linguistique met les langues scandinaves à portée de la main, du moins passivement. Muni de ce formidable atout et poussé par ma curiosité j’ai appris à scruter les cultures de l’époque moderne (sans oublier pour autant celles de l’époque contemporaine) par le biais de leur propre production textuelle, par l’intertextualité linguistique, et par la façon particulière dont chaque culture se servait de la langue, dans son for intérieur et au contact des autres.
Ce qui m’intéresse n’est donc pas tellement la langue classique, noble, mais le parler de tous les jours dans une société où la langue était encore assez peu standardisée, le bricolage linguistique, la façon dont les gens utilisaient l’une ou l’autre langue pour jouer sur tel ou tel registre de la sociabilité, de la compétence ou simplement du pouvoir, et comment les langues interféraient pour changer la donne: la francisation du hollandais des élites régnantes, par exemple (dont le grand pensionnaire Jean de Witt est un bel exemple), qui s’opposait au purisme des marchands épris de littérature tel le grand poète, dramaturge et marchand bonnetier Joost van den Vondel, mais aussi aux dialectes et sociolectes des exclus du pouvoir ou des rivaux d’autres territoires. Comment s’entendait-on dans cette petite Hollande du Siècle d’Or, où des dizaines, voire peut-être des centaines de milliers de francophones et d’Anglais, et plus encore d’Allemands ou de Scandinaves avaient cherché un refuge religieux, politique ou économique? On sait que les ‘expats’ français de qualité ne s’intégraient guère au pays: un Scaliger, un Saumaise, un Pierre Bayle, de grands érudits certes, restaient au fond des étrangers pitoyables incapables d’acheter correctement un pain au coin de la rue. Mais combien d’autres ont su trouver une entente sans perdre pour autant leur identité linguistique et culturelle?
Ceci est précisément un aspect qui me fascine dans le pays dont j’ai fait mon territoire de chasse préféré depuis une dizaine d’années: la colonie de la Nouvelle Hollande, autrement dit l’actuel État de New York et ses environs, au XVIIe siècle. Deux anecdotes seulement: le missionnaire jésuite français Isaac Jogues, en fuite devant les indiens Iroquois qui l’avaient affreusement torturé, fut en 1640 chaleureusement reçu par les calvinistes de la Nouvelle Amsterdam. Dans sa lettre à sa patrie, il acclame l’affirmation du gouverneur hollandais (lui-même un ancien négociant sur La Rochelle) selon lequel on parlait pas moins de dix-huit langues dans sa bourgade de mille habitants à peine sur la pointe Sud de Manhattan. S’y ajoutaient les langues indigènes, aussi nombreuses que les tribus, et tellement difficiles que l’un des colons Hollandais, qui pourtant fit de sérieux efforts pour les apprendre, affirma un jour que les Indiens en changeaient tous les deux ans pour égarer les Européens. Sans même parler des esclaves noirs avec leur langues africaines. Comment s’entendait-on dans une telle société ? Quels étaient les outils linguistiques, culturels, sémantiques qu’on mettait en œuvre pour construire une société viable, portée autant que possible vers un avenir souriant ? A y regarder de plus près, on distingue différentes stratégies: celle du bricolage linguistique de tous les jours, mais aussi une stratégie politique de la langue, et des stratégies identitaires propres aux groupes qui peu à peu se découvrent une identité ethnique qu’ils essaient de cimenter par la proclamation de leur autonomie linguistique. Tel fut, par exemple, le sort de la langue néerlandaise elle-même qui après la passation des pouvoirs aux Anglais en 1664 demeura la langue de l’orthodoxie réformée et du piétisme à New York, et la langue de la culture ancienne dans les régions rurales.
Ce sont ces mécanismes que je m’efforce d’analyser dans mes livres et articles, eux-mêmes écrits en plusieurs langues. En français, on pourra consulter notamment:
- « Modèles éducatifs et circulation des hommes: les ambiguïtés du second Refuge », in: La Révocation de l’Édit de Nantes et les Provinces-Unies, 1685. Colloque international du Tricentenaire, Leyde, 1-3 avril 1985 (Amsterdam/Maarssen: APA – Holland University Press, 1986), pp. 51-75.
- « Le français et son usage dans les Pays-Bas septentrionaux », in: Documents pour l’histoire du français langue étrangère ou seconde, n. 3 (juin 1989), pp. 1-8.
- « L’usage du français en Hollande, XVIIe-XIXe siècles: propositions pour un modèle d’interprétation », in: Études de linguistique appliquée, nouv. série, n. 78 (avril-juin 1990), pp. 17-26.
- « Le plurilinguisme des élites en Europe de l’Ancien Régime au début du XXe siècle », in: Le Français dans le Monde. Numéro spécial: Vers le plurilinguisme des élites, éd. Daniel Coste & Jean Hébrard (février-mars 1991), pp. 120-129.
- « Comenius et les Pays-Bas: une interprétation », in: Hana Voisine-Jechova (éd.), La visualisation des choses et la conception philosophique du monde dans l’œuvre de Comenius (Paris: PUP-Sorbonne, 1994), pp. 19-39.
- « La formation des négociants de la République hollandaise », in: Franco Angiolini & Daniel Roche (éd.), Cultures et formations négociantes dans l’Europe moderne (Paris: Éd. de l’EHESS, 1995), pp. 175-198.
- « Autodidaxies, XVIe-XIXe siècles: jalons pour la construction d’un objet historique », Histoire de l’éducation, nº 70 (mai 1996), pp. 5-27.
- « Le Français en Hollande après la Paix de Westphalie: langue d’immigrés, langue d’envahisseurs, ou langue universelle? », in: Documents pour l’histoire du français langue étrangère ou seconde, no. 18 (décembre 1996), pp. 329-350.
- « Le Paris vécu des Néerlandais: de l’Ancien Régime à la Restauration », in: Marie-Christine Kok Escalle (éd.), Paris: de l’image à la mémoire. Représentations artistiques, littéraires, socio-politiques (Amsterdam & Atlanta: Rodopi, 1997), pp. 8-36.
- Histoire de la diffusion et de l’enseignement du français dans le monde (avec André Reboullet). Numéro spécial de Le Français dans le Monde (janvier 1998), 192 p.
Une ébauche de problématique concernant l’ex-Nouvelle Hollande:
- « Reinventing an old fatherland: The management of Dutch identity in early modern America », in: Regina Bendix & Herman Roodenburg (eds.), Managing identity. Perspectives from folklore studies, history and anthropology (Amsterdam: Het Spinhuis, 2000), pp. 121-141.
Enfin, avec ma collègue Marijke Spies, professeur de littérature néerlandaise, j’ai publié récemment une synthèse sur la culture néerlandaise au Siècle d’Or dans laquelle la langue joue un rôle structurel. Nous y avons lancé de concept de ‘culture de discussion’ pour caractériser cette société. L’ouvrage paraîtra bientôt en anglais, sous le titre: 1650: Hard-won Unity (Assen: Van Gorcum, 2003).
Willem Frijhoff