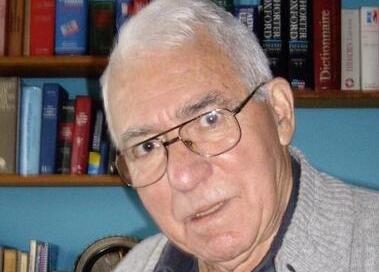Henri Besse

Ancien élève de l’École normale supérieure de Saint-Cloud (1961-1965), agrégé de lettres modernes (1965), Henri Besse a enseigné à l’Université de Saint-Andrews (Royaume-Uni, Écosse) et à l’Université du Caire (Égypte). Devenu enseignant-chercheur à l’ENS de Fontenay/Saint-Cloud, il a dirigé le Centre de Recherche et d’Étude pour la Diffusion du Français (CRÉDIF) de 1989 à 1992, avant de devenir maître de conférences hors-classe à l’ENS Lettres et Sciences humaines de Lyon, où il a co-dirigé la section « Sciences du langage ». Docteur d’État es Lettres et Sciences humaines, il est membre de l’équipe de recherche UMR 7597 « Histoire des théories linguistiques ». Spécialisé en sciences du langage et en didactique des langues, il a publié une centaine d’articles et plusieurs ouvrages portant sur ces domaines. Sa première publication concernant l’histoire de l’enseignement du français date de 1979. Il répond aujourd’hui, dans les lignes qui suivent, aux questions que nous lui avons posées sur l’intérêt de combiner dans une carrière scientifique « point de vue synchronique » et « approche diachronique ».
1) Quelle est la place de l’histoire dans ta réflexion sur la nécessité d’une relative autonomie de la didactique des langues par rapport à la linguistique ?
L’objectif de « La SIHFLES au singulier » est, si je comprends bien, de faire en sorte que l’impétrant se livre à une sorte d’autobiographie intellectuelle, à être en quelque sorte introspectif et rétrospectif, ce qui fait que j’ai eu quelque réticence à y participer.
J’ai eu longtemps des préventions contre l’histoire, liées sans doute à une formation secondaire où les sciences dites exactes avaient plus d’importance que les lettres. Mes professeurs d’histoire étaient ou bien anecdotiques ou bien par trop marxistes, et je trouvais que les historiens que j’avais dû lire, alors que je préparais le concours de l’ENS de Saint-Cloud, écrivaient plutôt mal, ce qui était alors, au moins à mes yeux, rédhibitoire. D’où ma répugnance à la « dissertation historique », où je ne voyais qu’une simple manipulation discursive, plus ou moins habile, d’un passé dont je pensais qu’il échappait en grande partie à ce qu’on pouvait en dire. Une remarque de saint Augustin m’avait beaucoup frappé, selon qui (je le cite de mémoire) le passé, le présent ou le futur n’existent pas, mais seulement la présence des choses passées, présentes ou futures. Ce qui me paraissait conforter les critiques de Paul Valéry à l’égard de l’histoire.
Quand j’ai commencé, en 1960, mes études de « lettres modernes » à Saint-Cloud et à la Sorbonne, j’ai été fortement déçu par les cours de littérature, qui n’étaient, le plus souvent, que des discours historiographiques sur la « vie et l’œuvre » d’écrivains ou de poètes dont parfois j’avais appris par moi-même à aimer autrement les textes. Quant aux cours de phonétique historique, ils me paraissaient tourner en rond dans une érudition masquant mal leurs apories (pourquoi, par exemple, était-on passé, à une époque incertaine, de la voyelle d’avant ei à la voyelle d’arrière oi ?). Les seuls cours m’ayant alors vraiment intéressé en Sorbonne (dont ceux de J.-C. Chevalier) étaient ceux de grammaire et philologie françaises, où je retrouvais quelque chose de ceux suivis à l’ENS avec R.-L. Wagner ou G. Gougenheim : un savoir sur le passé à même d’aider à mieux comprendre notre présent.
Quand je suis entré au CRÉDIF en octobre 1967 (et donc revenu à l’ENS après avoir enseigné la phonétique historique et la littérature médiévale à l’université du Caire), mon intention était de faire une thèse sur Vaugelas et la grammaire de Port-Royal (ce que Michel Foucault en avait écrit me paraissait critiquable). M. Dabène alors directeur du CRÉDIF, à qui j’en avais fait part, me répondit que je n’aurais guère le loisir de travailler à un tel sujet. Il en résulta que le point de vue synchronique l’a longtemps emporté dans les articles que j’ai commencé alors à publier, et que le premier sujet de thèse d’Etat que j’ai déposé, en 1971, portait sur « Les déictiques et l’organisation du discours ». J’y voyais un moyen d’approfondir ce que P. Guberina appelait « la parole en situation », et donc de combiner mon travail de formateur au CRÉDIF avec de plus anciennes préoccupations (voir ci-dessus la remarque de saint Augustin).
Les histoires de l’enseignement des langues, dont les 25 Centuries of Language Teaching de L. G. Kelly, m’avaient laissé insatisfait. Retrouver des « exercices structuraux » dans les manuels du 15e siècle me paraissait plus polémique que sérieux ; mais voir en quoi ces exercices anciens aidaient à mieux comprendre les exercices du 20e siècle me semblait, et me semble encore, plus intéressant. C’est en hommage à G. Gougenheim que j’écrivis en 1979, pour Le français dans le monde n° 148, mon premier article à caractère historique, mais d’histoire récente : « Contribution à l’histoire du Français Fondamental ». J’avais été frappé que, dans un recueil d’articles parus entre octobre 1951 et août 1952 à propos de ce qui n’était encore qu’un projet, bien peu de réflexions résistaient à l’épreuve d’un temps relativement court. Se discerne dans cet article la prise de conscience, encore vague, qu’un certain savoir sur le passé permet de « s’étonner de ce qui va de soi » (Paul Veyne) dans notre pensée présente, et donc d’en interroger les présupposés. Plus tard, je suis devenu membre de l’UMR « Histoire des théories linguistiques », dont les travaux et les discussions m’ont beaucoup appris. Mais je ne me considère toujours pas comme un véritable historien de la didactique des langues, puisque ma pratique consiste à instrumenter un certain savoir sur le passé afin de questionner, au risque de mettre en cause ce qu’on appelle parfois un peu hâtivement le progrès des connaissances, les convictions théoriques des linguistes ou des didacticiens actuels. C’est du moins ainsi que j’en ai usé dans ma thèse d’Etat, dont j’avais déposé le sujet en 1985 et que je n’ai soutenue qu’en juin 2000.
2) En quoi la réalisation d’outils pédagogiques, comme Interlignes, a-t-elle aidé, ou entravé, ton activité de théorisation ?
Elle l’a entravée en raison du temps qu’elle m’a pris (quatre ou cinq ans pour « Interlignes »), mais elle l’a aussi beaucoup aidé, tout comme les dizaines de classes que j’ai eu l’occasion d’observer au cours de mes missions, en m’incitant à intégrer, dans ma réflexion théorisante, diverses observations empiriques dont ne tiennent pas toujours compte les théorisations linguistiques ou didactiques actuelles.
Il existe d’ailleurs une analogie entre ma réflexion à visée scientifique, en particulier quant à l’usage que j’y fais de l’histoire, et l’expérience éprouvée quand on commence à apprendre une langue étrangère, quand on y parvient à discriminer des sons, des morphèmes ou des effets pragmatiques que notre langue de départ nous avait accoutumé à confondre ou à percevoir comme « naturels ». C’est en quelque sorte apprendre à goûter « l’admirable sensation » dont parlait V. Ségalen, à ressentir ce qu’on est en découvrant ce qu’on n’est pas. A l’exotisme synchronique d’un ailleurs culturel, l’histoire peut substituer un exotisme diachronique, du moins si l’on y veille à apprivoiser le passé sans trop le réduire à nos catégories présentes.
3) Quelles sont les figures du passé qui t’ont le plus marqué ? Beauzée, Du Marsais, Radonvilliers… ? Par leurs réflexions mais aussi par leur « personnalité » (faire l’histoire, c’est aussi rencontrer des personnes plus ou moins marquantes ou attachantes…).
Pour m’en tenir aux trois que tu cites, Du Marsais et Radonvilliers m’ont plus marqué que Beauzée, en raison précisément de ma réponse à ta question précédente. On sait peu de choses sur Beauzée, mais il semble avoir davantage enseigné un savoir sur les langues, celui de la Grammaire générale, que les langues elles-mêmes. On trouve, au contraire, chez Du Marsais et Radonvilliers des bonheurs de plume, des remarques ou des exemples qui attestent d’une longue familiarité avec l’enseignement des langues, quand il s’agit non « de faire par science ce que les autres font seulement par coutume » (A. Arnaud et Cl. Lancelot dans la préface à leur grammaire), mais de faire en sorte qu’un élève parvienne à s’accommoder à une autre coutume que la sienne.
4) L’histoire de la linguistique est une discipline qui a maintenant pignon sur rue. Pourquoi n’en va-t-il pas de même pour l’histoire de l’enseignement des langues ?
J’ai entendu, récemment, des spécialistes de l’histoire de la linguistique se plaindre d’être moins bien reconnus que ceux de l’histoire des sciences mathématiques ou physiques. Il me semble que la hiérarchie de ces « histoires de… » suit, dans les institutions universitaires, la hiérarchie des sciences dont elles traitent. Or l’enseignement des langues vivantes a été considéré dans les universités, depuis qu’elles y ont été introduites, comme relativement subalterne, y compris dans les départements dont c’est la spécialité où enseigner des savoirs sur les langues est considéré comme plus noble qu’enseigner ces langues mêmes. Un des intérêts de l’histoire de leur enseignement est peut-être de le promouvoir en un savoir qui le rende mieux à même d’être reconnu. Il me semble que la SIHFLES y contribue.
(Propos recueillis par Michel Berré.)